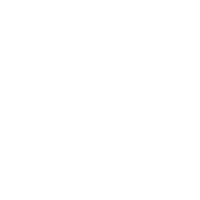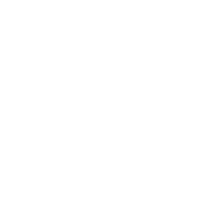Partager la publication "Burkina Faso: Le départ du président, un changement dans la continuité"
Le 31 octobre 2014, Blaise Compaoré, qui présidait le Burkina Faso depuis 1987, démissionnait de ses fonctions présidentielles sous la contrainte de l’armée et de l’insurrection d’une grande partie de la population. La rapidité des événements qui ont précipité le départ du président Compaoré peut sembler déconcertante. Pourtant, ces développements politiques s’inscrivent dans une continuité historique spécifique et dans un contexte africain marqué par un débat sur le respect de la constitution.
Retour sur les événements
En septembre 2014, les députés de la majorité présidentielle, le Congrès pour la démocratie et le Progrès (CDP), travaillaient sur une proposition de loi visant à convoquer un référendum pour modifier la Constitution et permettre à Blaise Compaoré de se présenter aux élections présidentielles prévue en 2015. L’article 37 de la Constitution du Burkina Faso n’autorisait pas un mandat supplémentaire au président sortant et les partis d’opposition manifestèrent leur désaccord contre le projet du CDP. À la fin du mois de septembre, le président Compaoré convoquait l’opposition et la majorité pour un dialogue qui déboucha sur une impasse. Malgré cela, un vote sur le projet de loi fut quand même prévu le 30 octobre 2014, renforçant la mobilisation de l’opposition. Le 29 octobre, le vote est annulé suite aux protestations de centaines de milliers de citoyens sortis manifester dans les grandes villes du pays. Mais la mobilisation prit une ampleur inattendue. Le 30 octobre, une foule survoltée saccagea l’Assemblée nationale et les locaux de la télévision nationale. Des militaires rejoignirent même les manifestants sur la Place de la Nation à Ouagadougou (la capitale). Forte de ce soutien, l’opposition politique demanda la démission de Blaise Compaoré. Au soir du 30 octobre, le Général Honoré Traoré annonçait la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée nationale. Un organe de transition de 12 mois fut institué dans la foulée. Le 31 octobre, le Lieutenant-Colonel Yacouba Zida annonça la fermeture des frontières ainsi qu’un couvre-feu de 19h à 6h du matin alors que Blaise Compaoré démissionnait dans la journée. Au soir du 31 octobre, le Général Traoré prit les fonctions de chef de l’État… remplacé le lendemain par le Lieutenant-Colonel Zida. Craignant une confiscation de l’insurrection populaire par l’armée, l’opposition et les organisations de la société civile obtinrent la mise sur pied d’un comité de concertation qui permit l’adoption mi-novembre d’une charte de transition. Le 18 novembre, l’ancien ministre des affaires étrangères, Michel Kafando, homme de consensus et de rassemblement, prête serment en tant que président de transition qui devrait durer 12 mois afin de préparer de nouvelles élections présidentielles prévues pour octobre 2015.
Le soulèvement populaire et le coup d’État militaire comme modes de changement politique
Les événements du 30 et 31 octobre 2014, loin de constituer un phénomène insolite dans le paysage politique burkinabè, s’inscrivent dans un contexte historique dans lequel le changement de régime est moins lié aux élections qu’à l’insurrection populaire et à la prise du pouvoir par l’armée. Dès 1966, une immense mobilisation de la population, rassemblant mouvements syndicaux, étudiants et diverses personnalités politiques, avait abouti à la chute du régime de Maurice Yaméogo, premier président du pays. Le Burkina Faso qui s’appelait alors la Haute-Volta était, à l’époque, confronté à une grande crise économique qui forçait l’État à adopter des politiques d’austérité. À l’annonce de cette rigueur budgétaire, la population se mobilisa et, devant la pression de la rue le Lieutenant-Colonel Sangoulé Lamizana prit le pouvoir au soir du 3 janvier 1966.
Lamizana dirigea le pays jusqu’en 1980. Son régime fut notamment marqué, à la fin des années 1970, par une période d’agitation avec des mobilisations de l’opposition politique et des syndicats qui provoquèrent une crise politique. Devant ce blocage, le Comité Militaire de Redressement pour le Progrès National (CMRPN), avec à sa tête le colonel Saye Zerbo, prit le pouvoir le 25 novembre 1980.
Le CMRPN, objet de vives tensions intestines, fut vite remplacé le 7 novembre 1982 par le Conseil de Salut du Peuple (CSP) dirigé par le Médecin-Commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Le CSP connut les mêmes contradictions que son prédécesseur et, le 4 août 1983, le Capitaine Thomas Sankara et ses compagnons, dont le Capitaine Blaise Compaoré, mirent fin au régime du CSP et instaurèrent le Conseil National de la Révolution (CNR). À l’instar du précédent régime, le CNR connut une fin tragique. Thomas Sankara fut assassiné le 15 octobre 1987 dans des circonstances qui demeurent encore troubles et son capitaine, Blaise Compaoré, prit le pouvoir qu’il conserva jusqu’en 2014.
Ainsi, nous observons bien que la fin du régime de Compaoré s’insère dans une continuité historique spécifique. Dans le Burkina Faso contemporain, le soulèvement populaire et le coup d’État militaire constituent les principaux modes d’action politique susceptibles de provoquer un changement de régime. Par ailleurs, il faut souligner que les conditions du départ de Blaise Compaoré en rappellent d’autres dans le contexte africain.
La constitution comme pomme de discorde
Depuis la dernière vague de démocratisation du début des années 1990, le respect des principes constitutionnels est au cœur du débat politique africain. Plusieurs chefs d’État africains ont tenté de réviser leur constitution pour se maintenir au pouvoir. Pourtant, certaines constitutions africaines comportent des dispositions limitant le nombre de mandats présidentiels dont l’objectif est de prévenir l’autoritarisme et favoriser l’alternance politique tout en empêchant le maintien à long terme d’un autocrate… même élu. Au Burkina Faso, la Constitution de 1991 introduisait une limitation du nombre de mandats présidentiels. Ce principe, aboli en 1997, réapparait en 2000. Il représentait à l’époque une concession faite par le pouvoir à l’opposition. En 2014, Blaise Compaoré souhaitait lever ce principe et prolonger son séjour au Kosyam (résidence du chef de l’État). Il n’a pas été le seul à vouloir le faire. En 2010, alors qu’il tente, sans succès, de modifier la constitution pour prolonger son mandat présidentiel, le président nigérien Mamadou Tandja se heurtait à l’opposition politique pour les mêmes raisons et l’armée finit par prendre le pouvoir[1]. En 2012, la candidature de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade fut contestée par une grande partie de l’opposition qui remettait en question sa légalité constitutionnelle.
Actuellement, d’autres pays africains comme le Gabon et la République Démocratique du Congo (RDC) connaissent les mêmes problèmes liés au respect de la constitution. En remettant en question les origines gabonaises du président Ali Bongo, les opposants au régime contestent la légitimité de son mandat actuel. En RDC, la situation est tendue avec des partis d’opposition qui accusent le président Joseph Kabila de vouloir prolonger son mandat par l’intermédiaire d’une loi électorale qui subordonne la tenue du scrutin présidentiel à l’achèvement d’un recensement de la population. Ces exemples montrent que les constitutions n’ont pas fini de faire parler d’elles en Afrique.
Ismaila Kane,
Doctorant en science politique à l’Université d’Ottawa.
[1] Lors de la crise nigérienne, le professeur de science politique de l’UdeM, Mamoudou Gazibo, fut nommé Président de la Convention chargée de la rédaction d’une nouvelle constitution pour le pays.
Pour approfondir le thème de la démocratisation en Afrique, Monde68 vous propose sa note de recherche sur: CORRUPTION, CROISSANCE ET DÉMOCRATIE EN AFRIQUE: L’IMPOSSIBLE CONSOLIDATION, par Guillaume A. Callonico, professeur de science politique et de relations internationales, et Directeur général de Monde68.