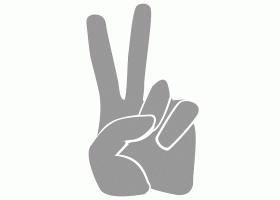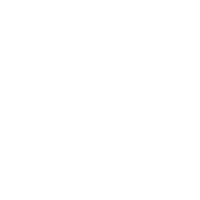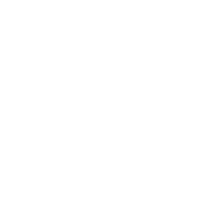La question des inégalités de revenu revient à l’avant plan depuis un certain nombre d’années. Le FMI, la Banque mondiale, l’OCDE lui consacrent régulièrement des études détaillées, révélant à la fois des disparités croissantes de revenus dans tous les pays et une concentration des richesses de plus en plus alarmante. Le Crédit Suisse dans son rapport « Global Wealth Databook » de 2013 rapporte que le 1% des plus fortunés concentrent entre leurs mains plus de 46% du patrimoine mondial. La classification annuelle de la revue Forbes nous montre d’année en année que le nombre de milliardaires ne cesse d’augmenter. Ils sont, en 2014, au nombre de 2325 et se partagent le pactole de 7300 milliards de dollars US, une augmentation de 12% par rapport à 2013. À l’échelle mondiale plus de 200,000 personnes détiennent une fortune excédant 30 millions de dollars dont une portion croissante provient de plus en plus des pays émergents faisant partie du BRIC et particulièrement d’Asie. Qui plus est, le rythme de progression des milliardaires et des millionnaires et leur patrimoine, ne cesse de croître, même en période de récession. Cette tendance est-elle à ce point inquiétante?
Particulièrement au 19e siècle, la répartition des revenus prenait une place centrale dans les théories des économistes classiques tels que Ricardo. On prenait alors pour acquis que du contrôle que l’on a sur l’une ou l’autre des ressources productives : la terre, le capital, le travail, découlait une rémunération. L’abondance du facteur travail et la rareté des deux autres facteurs maintenait les travailleurs à un niveau de subsistance et assurait aux détenteurs du capital et de la terre, une rente, des loyers, des profits disproportionnés. La critique du capitalisme de Karl Marx est éloquente à cet égard. Au tournant du XXe, on admet que seule la contribution à la production, la productivité, déterminait la juste part qui revient à chacun des facteurs. Le processus d’industrialisation et d’urbanisation progressant, le poids du facteur terre décroit et la propriété immobilière, d’abord dans les villes, devient une composante importante du capital. Aujourd’hui seuls deux facteurs tirent des revenus de la production : du facteur travail ce sont les salaires, commissions et autres avantages et du facteur capital (propriété directe des entreprises, capital financier et immobilier) des profits, des intérêts, des dividendes et bien entendu de gains de capitaux.
Dans les années 50, Kuznets, un économiste américain, démontre que les inégalités de revenus entreprenaient une tendance séculaire à la baisse. Le développement économique généralisé, la diffusion des technologies, l’accès à l’éducation accorderait à la classe montante éduquée un pouvoir et des revenus élevés. C’est l’aboutissement d’un système méritocratique accompagné d’une grande mobilité sociale. Ce constat était sûrement vrai à court terme mais n’avait aucune valeur universelle ou prédictive comme nous le verrons plus loin. Certes, un développement économique soutenu réduit les inégalités et par le fait même le poids des rentes venant des héritages et du capital. La question des revenus et des inégalités devait rester à l’ombre pendant quelques décennies après.
En septembre 2013, Thomas Piketty, dans son ouvrage magistral : Le capital au XXIe siècle apporte une perspective historique de longue durée en faisant remonter les données statistiques à 1700. Il met à contribution à la fois la sociologie, l’histoire, la littérature, l’économie politique. Il fait ainsi, un pied de nez au recours excessif aux mathématiques et aux modèles économétriques abstraits très en vogue parmi les théoriciens contemporains.
Au cœur de l’analyse de Piketty se trouve le rapport Capital/Revenu qu’il désigne par β et qui correspond au ratio du stock de capital, tel que défini plus haut et qui est nécessaire pour atteindre un certain volume de production ou de revenu national. Jusqu’en 1914, β[1] est très élevé. Il atteint dans plusieurs pays d’Europe 650 à 700%, un peu moins en Amérique du nord. L’accumulation du capital est alors considérable. Partant d’un retour sur le capital symbolisé par r, équivalent au taux de rendement du capital, en moyenne de 5%, Piketty présente la première loi du capitalisme α= rβ[2] dans laquelle α donne la part qui revient au capital dans le revenu national. Compte tenu de la concentration énorme du capital entre les mains des 10% les plus riches et encore davantage en proportion pour le premier centile, la part qui revient aux détenteurs de capital α est exorbitante. Nous faisons face à une économie de rentiers. Les forces en présence vont dans le sens de la divergence.
Après les deux guerres mondiales jumelées à la crise très grave des années 30 on assiste à la destruction physique d’une bonne partie du stock de capital, ainsi que d’une portion énorme du patrimoine financier de la classe possédante. Ce constat est encore plus vrai en Europe et dans certaines parties de l’Asie qu’aux États-Unis. Ce retour en arrière du capital favorise prodigieusement la montée de la classe moyenne dans la plupart des pays industrialisés. Le rapport capital/revenu, β, baisse de 650% à 250% et la part qui revient au capital α baisse aussi. Le taux de croissance économique soutenu durant les 30 années après la guerre, appuyé par des politiques sociales et un taux d’imposition marginal progressif mordant qui atteint plus de 80% aux États-Unis, permet à la classe moyenne d’accéder à une part du capital et des revenus issus de ce capital. Les baby boomers accèdent enfin à la propriété et pour la première fois à des régimes de retraite. Nous passons d’une société de rentiers telle que vécue avant 1914 à une société caractérisée par des inégalités de revenu nettement plus faibles. Dans la plupart des pays industrialisés 70% du revenu national va aux salaires et 30% au capital. Les forces de convergence l’emportent sur les forces de divergence, du moins pour une brève période.
À partir du début des années 80, à la faveur de transformations structurelles, entreprises d’abord dans les pays anglo-saxons, les super-cadres des grandes multinationales des secteurs bancaires et financiers puis des secteurs industriels, informatiques etc. voient leurs salaires atteindre des sommets inégalés. La déréglementation, les nombreuses dénationalisations, la totale liberté de circulation des capitaux, la mondialisation, la croissance spectaculaire de plusieurs économies émergentes et leur participation active au sein de l’économie mondiale accentuent davantage cette tendance. Elle devient globale. Les salaires, bonus et autres « stock options » que les super-cadres se sont accordés à eux-mêmes ont joué un rôle puissant à la fois dans les inégalités de revenu mais aussi dans les inégalités du capital. Ces niveaux astronomiques[3] de rémunération rendent possible une telle accumulation de capital et par conséquent de revenus découlant de ce capital, qu’ils finissent par expliquer, selon Piketty, les deux tiers des inégalités croissantes de revenu depuis un peu plus de trente ans. Les enfants des super-cadres contrairement à leurs parents seront à coup sûr des rentiers. La délocalisation de la production de plusieurs secteurs, contribue à fragiliser le pouvoir des syndicats. Une distinction de plus en plus marquée s’installe entre la fraction de la main d’œuvre scolarisée, branchée sur les nouvelles technologies et le reste des travailleurs, creusant ainsi davantage le fossé des inégalités. Il s’agit d’une rupture très nette par rapport aux années d’après-guerre.
Le rapport capital/revenu, β, est en phase de rattraper et peut-être même dépasser, les niveaux qu’il avait atteint avant 1914. Certes, les crises boursières et immobilières à la manière de celle des valeurs technologiques de 2001 ou celle accompagnant la récession de 2008 apportent un recul passager mais qui est assez vite comblé. Les données démographiques[4], le ralentissement des taux de croissance militent en faveur de la reconnaissance d’une 2e loi fondamentale du capitalisme :
β = s/g et dans laquelle le rapport capital/revenu β devrait tendre à long terme vers le rapport de s/g soit le rapport du taux d’épargne sur le taux de croissance de l’économie. D’une part, l’accumulation du capital, à cause même de la stabilité du taux de rendement[5] du capital, de l’ordre en moyenne de 5% par année, garantit un taux d’épargne élevé dans le futur. D’autre part un ralentissement continuel des taux de croissance[6] multiplie les chances de pouvoir observer à long terme un rapport capital/revenu de plus en plus élevé et par conséquent des revenus de plus en plus inégalitaires. La financiarisation de l’économie mondiale et les besoins insatiables en capitaux de la nouvelle économie assure aux détenteurs de capitaux des revenus croissants. On est à mille lieux de la baisse tendancielle des taux de profits de Karl Marx. Sommes-nous prêt à passer d’une société méritocratique à une société patrimoniale? Faudra-t-il apporter des correctifs à cette fuite en avant du capital?
Armand Sebbag
Professeur d’économie au Collège Jean de Brébeuf
[1] Piketty.pse.ens.fr/capital21c
[2] Si r=5% et β =700% α =35%
[3] Les salaires des hauts dirigeants sont + de 1000 fois supérieurs au salaire moyen
[4] La croissance démographique justifie la moitié du taux de croissance, le reste est dû à la technologie.
[5] Le rendement des grandes fortunes ou celui des grandes fondations telles celles de Harvard ou Yale, des fonds souverains, excède 10%
[6] Le taux de croissance mondial élevé passé vient en bonne partie des économies émergentes qui se trouveront de moins en moins en phase de rattrapage dans l’avenir.