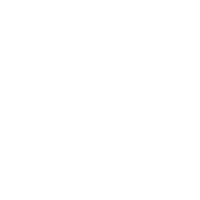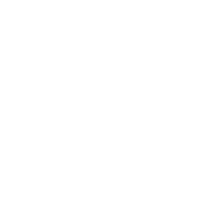Partager la publication "DOSSIER EUROPE – Le projet européen : du rêve au cauchemar?"
La disparition d’États, d’empires ou d’organisations internationales est un phénomène extraordinairement rare. Ma génération a pu témoigner de l’effondrement de l’Union soviétique en moins de deux ans (1989-1991). Mais les contemporains de la chute de Rome ne s’en sont probablement pas rendu compte tant cette chute a duré des siècles. Sauf en cas de défaite militaire, les structures politiques font preuve d’une grande résilience.
En sera-t-il de même de l’Union européenne? Il y a moins d’un an, rares sont ceux qui se seraient aventurés à prédire la fin de ce projet lancé après la Deuxième Guerre mondiale par deux ennemis historiques, la France et l’Allemagne, bientôt rejoints par la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Italie et 22 autres pays.
Depuis, la « polycrise », un terme employé par président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour décrire les dysfonctionnements de la zone Euro, l’incapacité à gérer l’afflux de réfugiés, le détricotage de la zone « Schengen » de libre circulation des personnes, la menace d’une sortie du Royaume-Uni (« Brexit ») et l’arrivée au pouvoir de gouvernements eurosceptiques en Hongrie et en Pologne, a installé un climat de sinistrose qui oblige à considérer tous les scénarios.
Trois scénarios
Le premier scénario, souhaité par la Commission européenne, la chancelière allemande Angela Merkel et des intellectuels comme l’économiste français Thomas Piketty, est celui d’un sursaut fédéral. Selon eux, l’UE est née dans un contexte difficile et elle a traversé les crises de l’histoire européenne en se renforçant toujours davantage. Face à l’adversité, son but demeure plus que jamais « l’union sans cesse plus étroite entre les peuples européens », préambule du Traité de Rome (1957), l’acte fondateur de l’UE.
Pour sortir de cette crise, il faudrait approfondir la démocratie européenne en confiant au Parlement supranational de nouveaux pouvoirs sur un budget commun considérablement étoffé. Rappelons que ce budget, plafonné à 1% du PIB des États-membres, ne permet pas actuellement à l’UE d’aider les pays et les régions qui, comme la Grèce ou le Nord de la France, vivent de graves difficultés économiques.
Avec un budget équivalent à celui d’un gouvernement fédéral, permettant la péréquation et l’investissement public, voire une caisse d’assurance-chômage commune, l’union économique ne s’appliquerait qu’à un noyau d’États désireux de renforcer leurs liens de solidarité, par exemple les 19 pays qui ont déjà adopté l’Euro comme monnaie commune. Le Brexit ne serait alors pas une grande menace puisque le Royaume-Uni, ayant conservé la livre sterling, ne ferait pas partie de ce groupe pionnier.
Le deuxième scénario est celui d’un bricolage, fait de compromis boiteux mais inévitables entre des États-membres qui sont devenus très interdépendants sur le plan économique, mais aussi social et politique.
La création de l’Euro en 1999 fut elle-même le fruit d’un tel compromis, entre la France qui voulait une monnaie commune et un budget européen mais pas d’institutions fédérales, et l’Allemagne qui acceptait une monnaie commune mais pas de budget commun sans institutions fédérales. Le compromis bancal, celui d’une union monétaire sans budget et sans institutions fédérales, n’a pas empêché la monnaie commune de survivre, à tel point qu’elle demeure une des devises de référence dans le monde.
Il n’est pas impossible que l’UE sorte de la crise actuelle avec une politique économique toujours nationale mais des fonds plus généreux pour aider les pays en difficulté, ce qui permettrait de dire qu’un début d’union économique est en marche; des contrôles aux frontières plus fréquents qu’au cours des 20 dernières années mais aussi une coopération renforcée entre les douaniers, ce qui permettrait de dire que la zone Schengen a survécu; ou encore une sortie du Royaume-Uni qui n’empêcherait pas un partenariat étroit avec ce pays comme c’est le cas entre l’UE et la Norvège ou la Suisse. Bref, des petits pas qui ne résolvent rien mais n’entraînent pas la fin de l’UE.
Le troisième scénario, rendu possible par la défiance croissante des opinions publiques à l’endroit du projet européen mais aussi par la méfiance des gouvernements les uns envers les autres, est celui de l’implosion.
On assisterait alors à une disparition de l’Euro qui serait remplacé par les anciennes monnaies nationales comme le franc français, la lire italienne ou le Mark allemand. Les contrôles aux frontières seraient rétablis et les millions de ressortissants européens qui vivent dans un autre pays que le leur en perdraient le droit automatique. Les pays bénéficiaires de l’aide européenne au titre de la « cohésion » (pays de l’Est mais Portugal, Espagne et Irlande) verraient un gros trou dans leur budget national. Sur la scène mondiale, les anciens membres de l’UE avanceraient en rangs dispersés en matière de lutte aux changements climatiques ou de commerce international. L’Europe serait affaiblie face à la Chine, la Russie et les Etats-Unis.
Il n’est pas impossible que les rancoeurs accumulées pendant le processus de divorce mènent à la résurgence de vieilles querelles, par exemple entre l’Allemagne et la République tchèque sur la question des expulsés de l’après-guerre. Une chose est sûre en tout cas : il deviendra beaucoup plus difficile de circuler, de travailler et de coopérer en Europe.
Explications
Au moment d’écrire ces lignes, on peut dire que, si le deuxième scénario demeure le plus probable, celui de de l’implosion n’a jamais été aussi près de se produire depuis les années 1960. Comment les Européens en sont-ils arrivés là? Sachant qu’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, j’avancerai néanmoins quatre explications possibles.
La première explication est celle de la fuite en avant, ou, pour prendre l’expression du politologue Frank Schimmelfennig, de la « trappe rhétorique » En 1999, l’UE a lancé une union monétaire incomplète – puisque tous les économistes lançaient l’avertissement qu’il fallait des institutions fédérales afin d’en amortir les effets asymétriques sur les économies nationales –, en se disant que l’union économique viendrait bien plus tard. Entre 2004 et 2007, l’UE a aussi accepté 12 nouveaux États-membres dont les niveaux de développement économique, de stabilité démocratique et de respect de l’État de droit étaient défaillants, en disant là encore « qu’on verrait plus tard ».
Aujourd’hui, la Grèce et le Portugal sont au bord du gouffre économique alors que la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie sont aux mains de partis autoritaires et xénophobes. Mais ce sont des problèmes pour les politiciens d’aujourd’hui, pas pour ceux qui ont pris des décisions hasardeuses il y a 15 ou 20 ans.
La deuxième explication, proposée par les politologues Gary Marks et Liesbet Hooghe, est celle d’un « dissensus contraignant ». Alors que l’UE jouissait jusque dans les années 1990 d’un « consensus permissif », les dirigeants nationaux seraient aujourd’hui davantage scrutés par leurs opinions, dont la confiance envers les institutions politiques est en chute. Dans ce contexte, les compromis entre gouvernements sont plus difficiles, surtout lorsqu’ils impliquent des sacrifices sur des questions techniques discutées par des personnes inconnues du grand public dans une langue étrangère à Bruxelles…
La troisième explication, même si elle est un peu facile, est celle de la médiocrité actuelle des dirigeants politiques. Pendant 40 ans, la politique européenne a été le fruit de compromis entre deux pays égaux, la France étant représentée par les présidents Charles De Gaulle, Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand, et l’Allemagne par les chanceliers Konrad Adenauer, Helmut Schmidt et Helmut Kohl. Les pays du Benelux faisaient des propositions audacieuses et les pays du sud étaient heureux de faire partie du club des démocraties.
Aujourd’hui, Angela Merkel est seule au front alors que le président français François Hollande et le premier ministre italien Matteo Renzi se préoccupent davantage de politique intérieure et l’Espagne n’a pas de gouvernement. Il y a donc un vide du pouvoir.
Mais je pense qu’il y a une quatrième explication, trop souvent négligée. Les mouvements xénophobes, les forces populistes et les propositions de repli sur soi ont le vent dans les voiles partout en Occident. Pensons au succès de Donald Trump aux Etats-Unis. La différence, c’est que ce vent souffle à Bruxelles sur une institution beaucoup plus fragile que les États-nations parce qu’elle n’a pas été légitimée par des siècles de construction nationale, à travers l’école, l’armée, la poste, la télévision, la religion, la langue, etc.
Comme l’ont montré l’anthropologue Ernest Gellner et le sociologue Michael Mann, presque partout, l’identité nationale a précédé l’expérience de la politique démocratique. Dans le cas de l’UE, c’est l’inverse. Or, demander aux citoyens de partager leur sort avec des gens qu’ils considèrent comme des étrangers, et ce alors même que leur situation économique semble se dégrader, ça n’a jamais été facile.
Frédéric Mérand
Professeur de science politique et Directeur du Centre d’Études et de Recherches Internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM)