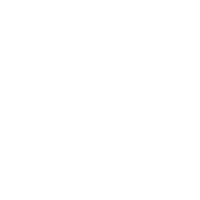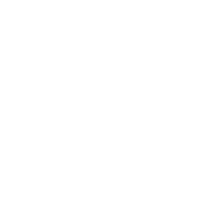Partager la publication "La nature en question : la philosophie face à la crise environnementale"
par Gabriel Malenfant
Depuis le divorce plus ou moins consumé des discours philosophique et scientifique, il n’est certes plus convenable de parler de « philosophie naturelle ».[1] Toutefois, dans la foulée des importants changements climatiques et environnementaux issus de la révolution industrielle, c’est par l’émergence d’une discipline à la frontière de l’écologie, de la phénoménologie et de l’éthique que la philosophie, au XXe siècle, a pu retrouver la nature pour mieux la questionner.
Trois conceptions de la nature (phusis)
Comme le font remarquer Pierre Hadot[2] et Gérald Hess,[3] déjà chez les Grecs, faire appel au concept de « nature » (phusis) signifie adopter l’une de ces perspectives à la fois sur ce qui entoure et constitue l’être humain :
1 – La perspective technoscientifique : la nature-artefact
D’après cette conception, la nature est une chose fabriquée, c’est-à-dire un objet dont la transformation porte la marque de l’être humain. C’est la nature utilisée et dominée par l’homme, au sens où elle est assujettie aux intérêts et besoins humains.
2 – La perspective phénoménologique : la nature-habitat
D’après cette autre conception, la nature est un environnement, une demeure (oikos), un lieu vécu. C’est la nature dont on fait l’expérience : elle est « perçue, contemplée, ressentie par l’homme », mais aussi « exprimée à travers ce point de vue humain »,[4] notamment par l’art et la philosophie.
3 – La perspective génétique : la nature-poïésis
Finalement, d’après cette dernière conception, la nature est ce qui se produit et se reproduit elle-même. C’est la nature comme création autonome, génération dynamique.
Or, bien que l’on puisse tracer l’origine de ces conceptions de la phusis chez les Grecs, celles-ci peuvent être vues à l’œuvre à tout moment dans l’histoire occidentale. Par exemple, de nos jours, nous pourrions dire que nous adoptons la perspective phénoménologique alors que l’on fait une promenade en montagne ou que l’on s’isole dans une clairière pour camper ou peindre. Nous adoptons aussi une perspective génétique sur la nature lorsque nous évaluons l’intégrité d’un écosystème ou que nous tentons de comprendre la filiation évolutive entre deux espèces animales. Pourtant, la perspective humaine sur la nature ayant eu le plus grand impact sur l’environnement terrestre depuis l’avènement de la science moderne (et principalement depuis la révolution industrielle) demeure la première, soit la perspective technoscientifique.
Heidegger et la technique
Bien que cette manière nécessaire et séculaire de concevoir la nature ne puisse être qualifiée d’intrinsèquement néfaste – après tout, il faut bien utiliser celle-ci et objectifier le monde, le réifier, ne serait-ce que pour s’en nourrir ou s’y loger –, le développement de la science moderne et de la technique qui lui est intimement liée permettra de modifier la nature d’une manière que l’on n’aurait jamais cru possible ne serait-ce que quelques décennies auparavant. C’est d’ailleurs la thèse que Martin Heidegger (1889-1976) a soutenue en 1949 dans un essai influent intitulé « La question de la technique ».
Pour résumer l’idée centrale de ce texte difficile, disons qu’Heidegger prend conscience de la puissance de la technique créée par la science moderne et expose la perspective technoscientifique pour ce qu’elle est. D’après lui, la nature est envisagée principalement, depuis l’industrialisation, comme réalité ‘mise à la disposition’ de l’homme. Elle est donc conçue dorénavant comme un stock de ressources attendant d’être capturées ou extraites, puis accumulées.
Ainsi, les autres perspectives sur la nature (proposées par l’art, la science fondamentale, la spiritualité ou l’expérience esthétique d’environnements sauvages, par exemple) seront évacuées des sphères d’influence politiques et économiques, sauf de façon marginale, parce que considérées futiles d’un point de vue instrumental.
Aussi, les êtres humains, eux-mêmes des êtres naturels pouvant être considérés comme des ressources à exploiter, en viendront à retourner contre eux cette perspective technoscientifique puisqu’aucune autre perspective ne sera à leur disposition, ce qui provoquera une déshumanisation concrète des individus.
En faisant une lecture contemporaine de « La question de la technique », on pourrait ajouter que la Seconde Guerre mondiale ainsi que les dictatures fascistes et communistes furent des exemples clairs de cette déshumanisation de l’Homme par la technique. Heidegger ayant lui-même participé à l’horreur nazie, le rapport qu’il entretient avec cette déshumanisation est au mieux équivoque.[5] En outre, malgré la fin de cette guerre et de ces régimes politiques particuliers, la technique, elle, demeura omniprésente au vingtième siècle : elle serait en effet devenue la perspective dominante sur ce qui nous entoure – même sur notre propre corps, instrumentalisable, transformable, optimisable. C’est précisément ce que Heidegger avait prédit. La perspective technoscientifique réifierait maintenant les êtres humains en visant leur uniformisation comme autant de consommateurs des ressources extraites de la nature à travers la production d’une culture massifiée et de sous-cultures globalisées par le biais de biens de consommation visant la reproduction de comportements génériques, politiquement toujours acceptables, mais écologiquement désastreux.
L’écologie et le fondement idéologique de la crise climatique et environnementale
Ainsi, par-delà l’influence heideggérienne sur la philosophie de l’environnement en Occident, c’est aussi beaucoup sur la base d’observations de la nature et de sa transformation par les êtres humains que plusieurs réflexions émergeront à la fin du vingtième siècle pour réclamer que l’on s’intéresse davantage à l’environnement en philosophie.
C’était par exemple déjà le cas en Amérique au moment où était prononcé la conférence de Heidegger sur la technique. Aux États-Unis, le forestier et écologue Aldo Leopold (1887-1948) publie (post-mortem) son Almanach d’un comté des sables (1949) :
« Les grues étaient mises à mal, leur nombre diminuait en proportion des prés encore non incendiés. Pour elles, le chant de la pelleteuse faillit bien se transformer en élégie. Les grands prêtres du progrès ne savaient rien des grues, et s’y intéressaient encore moins. Qu’est-ce qu’une espèce de plus ou de moins pour les ingénieurs? Et de toute façon, à quoi peut servir un marais non asséché? […]
Ainsi l’Histoire, des marais comme des marchés, s’achève-t-elle toujours sur un paradoxe. La valeur suprême de ces marais, c’est leur caractère sauvage, et la grue est la sauvagerie incarnée. Mais toute protection de la vie sauvage est vouée à l’échec, car pour chérir, nous avons besoin de voir et de caresser, et quand suffisamment de gens ont vu et caressé, il ne reste plus rien à chérir. […]
L’écologie n’arrive à rien parce qu’elle est incompatible avec notre idée abrahamique de la terre. Nous abusons de la terre parce que nous la considérons comme une commodité qui nous appartient. Si nous la considérons au contraire comme une communauté à laquelle nous appartenons, nous pouvons commencer à l’utiliser avec amour et respect. Il n’y a pas d’autre moyen si nous voulons que la terre survive à l’impact de l’homme mécanisé, et si nous voulons engranger la moisson esthétique qu’elle est capable d’offrir à la culture.
La terre en tant que communauté, voilà l’idée de base de l’écologie, mais l’idée qu’il faut aussi l’aimer et la respecter, c’est une extension de l’éthique. »[6]
La critique du progrès technoscientifique et de la conception de la nature sur laquelle ce dernier repose était donc belle et bien vivante tant sur le continent américain qu’en Europe. Et c’est grâce à ces critiques qu’un nouveau champ d’étude philosophique est né : la philosophie de l’environnement, et plus précisément, l’éthique environnementale.
Que faire pour penser l’anthropocène?
Les pronostics heideggérien et léopoldien de 1949 pouvaient il n’y a pas si longtemps sembler catastrophistes, mais depuis la deuxième moitié du vingtième siècle, de nombreux penseurs[7] et scientifiques[8] voient ces prédictions soit comme s’étant déjà produites, ou alors en voie de se produire. Plusieurs faits[9] maintenant établis par les sciences de l’environnement semblent en effet leur donner raison, car ils montrent que la nature est exploitée par les êtres humains par-delà ce qu’elle peut donner et régénérer.
Aussi, ce que l’appauvrissement dramatique de la
biodiversité et les changements climatiques rendent manifeste de concert, c’est
que cette nouvelle ère d’extinction que l’on nomme maintenant « l’anthropocène »[10] semble être la
conséquence non seulement de facteurs économiques, historiques, politiques,
sociologiques et technologiques : en définitive, ces facteurs eux-mêmes
reposeraient sur un socle idéologique qu’il faudra nécessairement remettre en question.
Voilà la tâche, commune et difficile, qui incombe aux sciences humaines et à la
philosophie.
[1] Agence France-Presse, « Le siècle où la philosophie naturelle est devenue la science », 25 février 2019. URL : https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2019/02/25/siecle-philosophie-naturelle-devenue-science [consulté le 24 avril 2019].
[2] Cf. Pierre Hadot, Le voile d’Isis (Paris : Folio, 2008).
[3] Gérald Hess, Éthiques de la nature (Paris : PUF, 2013). La classification des conceptions de la nature présentée ici est issue de cet ouvrage de référence.
[4] Ibid., 47.
[5] Cf. Emmanuel Faye, Heidegger : l’introduction du nazisme dans la philosophie (Paris : Albin Michel, 2005).
[6] Aldo Leopold, Almanach d’un comté des sables (Paris : GF-Flammarion, 2000 [1949]), 15 et 133-4.
[7] Cf. par exemple, Hans Jonas, Le principe responsabilité (Paris : Champs, 1979) pour un ouvrage philosophique ou Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, Mal de Terre (Paris : Seuil, 2003) pour un ouvrage plus grand public.
[8] Cf. par exemple, le dernier rapport du GIEC datant d’avril 2019 concernant les changements climatiques : « Global Warming of 1.5C ». URL : https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/
[consulté le 6 mai 2019]
.
[9] Voir par exemple l’ouvrage dirigé par Michel Petit, Climat : Le temps d’agir (Paris : Cherche midi, 2015).
[10] Cf. Ian Rappel, « Fear and Self-Loathing in the Anthropocene », The Ecologist, 2 mai 2019. URL: https://theecologist.org/2019/may/02/fear-and-self-loathing-anthropocene
[consulté le 6 mai 2019]
.