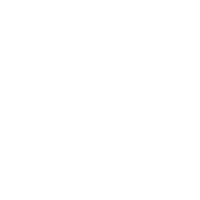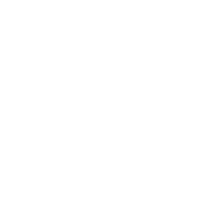Quand, le 3 mars, Benyamin Natanyahu s’est adressé au Congrès américain à la barbe de l’administration Obama, il ne parlait pas que pour son gouvernement. C’est la volonté d’une constellation hétéroclite désireuse de pousser à fond l’affrontement américano-iranien qu’il exprimait. On y retrouvait aussi les néocons américains, le lobby sioniste aux États-Unis, le gouvernement français et l’Arabie saoudite. Cette dernière aurait pu représenter le groupe, n’eût été le fait qu’un dirigeant israélien est pratiquement chez lui aux États-Unis, même admissible à la fonction de chef de facto de l’opposition officielle à un président en exercice. Aussi « spéciale » que puisse être la relation américano-saoudienne, elle n’a pas atteint le degré d’interpénétration symbiotique de la relation américano-israélienne.
Quoi qu’il en soit, États-Unis et Arabie saoudite sont liés depuis 70 ans sur le plan politique et depuis 82 ans sur le plan pétrolier. L’appariement entre la grande puissance capitaliste, prétendante au rôle de porte-drapeau du libéralisme, et du royaume à la structure sociale jusqu’à récemment tribale et héraut de l’islam fondamentaliste, n’a rien de prédestiné. Mais nécessité fait loi. Après Israël, l’Arabie saoudite est le pilier principal de la position américaine au Moyen-Orient. Non que cette relation ait été sans vicissitudes ou tensions. De fait, mésententes et divergences ont à quelques reprises laissé présager la rupture. Mais trop d’intérêts communs ou l’absence d’alternatives retiennent les partenaires en tandem.
Dans la conjoncture actuelle, la question iranienne s’apparente à une pomme de discorde régionale et un miroir grossissant des soucis que suscitent les grandes évolutions des (dés)équilibres mondiaux. À peine instaurées, l’unipolarité post-guerre froide et l’hégémonie américaine amorcent leur déclin, annonçant d’importants réalignements internationaux. Quid de l’alliance américano-saoudienne ? Si ce partenariat n’en est pas à sa première épreuve, la mutation en cours est-elle susceptible d’en venir à bout ? Pour y répondre, il convient d’abord de scruter l’expérience du passé, ensuite d’évaluer si une recomposition internationale entraînerait des changements dans la relation américano-saoudienne.
1945-1973 : pétrole contre sécurité
La relation américano-saoudienne est d’origine pétrolière. La précieuse huile jaillit en Perse en 1908, puis en Irak en 1927. L’Arabie saoudite accorde une concession à la Standard Oil of California (SOCAL) en 1933. Contre un paiement forfaitaire de 30 000 £, tout le pétrole trouvé en Arabie orientale lui reviendrait. C’est le contrat du siècle, la caverne d’Ali Baba. Le concessionnaire découvre en 1938 un vaste champ pétrolifère et d’énormes réserves. D’autres sociétés américaines font leur entrée.
Du coup l’Arabie saoudite, devenue un royaume seulement en 1932, accède à la catégorie des producteurs de premier rang. Les intérêts américains s’invitent ainsi dans une région soumise, comme son pétrole, à l’influence prépondérante de la Grande-Bretagne et des pétroliers britanniques. Les tentatives britanniques de prendre pied dans la péninsule durant la Seconde Guerre mondiale sont repoussées.
À base économique, la relation acquiert une dimension politique d’État à État lorsque le président Roosevelt, de retour de la conférence de Yalta en février 1945, rencontre le roi saoudien Abd el-Aziz à bord du USS Quincy sur le canal de canal de Suez. Le marché conclu consiste en une garantie saoudienne des approvisionnements pétroliers des États-Unis et américaine de la sécurité de l’Arabie saoudite. La construction d’une base aérienne par les États-Unis concrétise l’entente. Avec le pacte de Quincy, les États-Unis se procurent un allié au Moyen-Orient, en fait un quasi-protectorat.
Outre son pétrole, ce partenaire a deux autres atouts : son idéologie wahhabite, version rigoriste et puritaine de l’islam, et sa détention des Lieux Saints de la Mecque et de Médine. Durant la guerre froide, la carte de l’islam est mise à contribution pour condamner l’athéisme dont l’URSS et le communisme seraient des vecteurs. Elle sert aussi contre le nationalisme panarabe et le républicanisme, menaçants pour les monarchies. Les nassériens sont en conflit ouvert avec ces pouvoirs qu’ils condamnent comme bastions de la réaction et valets de l’impérialisme.
Dans ce contexte, États-Unis et Arabie saoudite sont proches, sauf lorsque les États-Unis courtisent l’Égypte nassérienne afin de l’éloigner de l’URSS. Ici pointe la configuration typique du différend américano-saoudien. Si leurs intérêts dictent aux États-Unis des réorientations politiques ou des rééquilibrages, leurs alliés sont appelés à s’en accommoder et à s’ajuster en conséquence. En l’occurrence, les divergences de vue entre Américains et Saoudiens ne remettent pas en question l’alliance.
1973-1980 : pétrole, dollar et sécurité
Compensant la dévalorisation de leurs revenus due à la dépréciation du dollar, les pays exportateurs de pétrole quadruplent les cours du brut, mettant fin à l’ère du pétrole bon marché. Tandis que leurs rentrées montent en flèche, se pose la question de l’emploi de ces masses de pétrodollars. Les pétromonarchies s’engagent à recycler leurs nouveaux revenus dans le système bancaire occidental.
Avec la fin du système de Bretton Woods et de la convertibilité dollar-or, le dollar flotte. Libellé en dollars, l’or noir se substitue de facto à l’or jaune comme garantie du dollar, lequel repose désormais sur le pétrole. Le maintien, notamment par l’Arabie saoudite, du lien pétrole-dollar soutient la demande mondiale de la monnaie américaine, devise de paiement des factures pétrolières. Grands bénéficiaires d’un statut spécial qui les exempte de frais de change, les États-Unis ont ainsi la faculté d’importer meilleur marché et d’emprunter à de plus faibles taux sur les marchés internationaux, autrement dit de vivre au-dessus de leurs moyens.
Les États-Unis ont d’autres raisons d’être redevables à l’Arabie saoudite. Financés par la manne pétrolière, ses achats d’armements augmentent brusquement, tout en demeurant soumis à l’autorisation du lobby israélien aux États-Unis. L’Arabie saoudite est le pays qui dépense le plus per capita au monde pour sa défense (un tiers du budget, 10% du PNB). [1] Elle n’a pas la capacité d’absorber ou de se servir par elle-même d’autant de moyens. Les plus complexes sont destinés à être utilisés conjointement avec des forces américaines. Entre-temps la politique d’achats remplit les carnets de commande des industries militaires américaines, mais aussi françaises et britanniques, et finance leur recherche-développement.
À côté de tels facteurs de solidarité américano-saoudienne, la hausse des prix pétroliers, l’appui de Ryad à l’Égypte et à la Syrie durant la guerre de 1973 et la critique des accords de Camp David de 1979 laissent peu de traces durables. Complétant le pacte de Quincy, la « doctrine » Carter (janvier 1980) déclare le libre accès au Golfe persique un intérêt vital des États-Unis, justifiant une intervention militaire de leur part.
1980-2001 : exportation du wahhabisme, naissance du djihadisme
En 1979, le renversement du chah d’Iran et l’intervention soviétique en Afghanistan sont l’occasion d’ajouter une fonction à la palette de l’Arabie saoudite. Devant la version khomeyniste de l’islam, le fondamentalisme wahhabite est dressé comme concurrent. Il est, par ailleurs, sollicité pour fournir des combattants intégristes en Afghanistan, le tout dans le cadre de la stratégie américaine d’enliser l’URSS dans une réédition de la guerre du Vietnam. Il est d’autant plus aisé de trouver des recrues à la guerre sainte que le reflux du nationalisme arabe dégage la voie aux courants islamistes. D’Arabie saoudite arrivent volontaires et financement.
En Afghanistan, les moudjahidin font le lit des talibans, tandis qu’émerge Al-Qaïda, matrice du djihadisme parrainé par l’Arabie saoudite, la CIA et les Renseignements militaires pakistanais. Empruntant au wahhabisme, couvé dans l’incubateur afghan, le djihadisme est surtout un fait militaire, soit des milices armées formées pour mener la guerre irrégulière à l’échelle mondiale. Actifs dans le démantèlement de la Yougoslavie (Bosnie, Kosovo), les djihadistes le sont aussi en Tchétchénie.
De concert avec les États-Unis, l’Arabie saoudite fait office de foyer idéologique et pécuniaire du djihadisme mondial, l’entraînement s’effectuant en Afghanistan. À la demande de la Maison blanche, et entre autres services, elle en vient à financer les Contras au Nicaragua. Les relations américano-saoudiennes sont étroites et, quoique embarrassante, l’intimité américano-israélienne ne leur fait pas ombrage.
2001-2005 : revirement américain et brouille
Tout change suite au retournement d’Al-Qaïda contre ses commanditaires, le djihadisme étant une arme à double tranchant. Déçu que son organisation n’ait pas été chargée de combattre l’armée irakienne au Koweït en 1990, Ben Laden est aurait été ulcéré de voir des centaines de milliers de soldats étrangers profaner la terre sainte de l’islam. Et c’est l’Arabie saoudite qui assume le coût de la guerre contre l’Irak ! S’adonnant désormais aux attentats lointains et spectaculaires, Al-Qaïda s’en prend directement aux États-Unis le 11 septembre 2001. Devenus cibles du djihadisme, les États-Unis changent d’attitude à son égard. En présence du soudain désaveu américain de leur progéniture commune, l’Arabie saoudite est prise à contre-courant.
Quinze des 19 kamikazes étant saoudiens, il y aurait une « Saudi connection ». Médias et politiciens américains se déchaînent contre le royaume, accusé de complaisance, sinon de complicité et de duplicité. L’allié d’hier, y compris dans le parrainage du djihadisme, est dépeint sous les couleurs les plus sombres. Tyrannique, corrompu, fanatique, infesté de qaïdistes, il serait sur le point de tomber aux mains des terroristes. Les jours de la monarchie seraient comptés.
Pourquoi la démesure ? Parce que l’argument de la « perte » imminente de l’Arabie saoudite facilite l’accréditation de l’idée d’occuper l’Irak pour en faire le nouveau point d’appui américain au Moyen-Orient, d’autant plus attirant que son abondant pétrole permet de compenser pour le saoudien « perdu ». Les néoconservateurs, dont c’est le dessein, sont à la manœuvre. Dans leur « Grand Moyen Orient », recomposition géopolitique de la région, l’Arabie saoudite est vouée au morcellement au même titre que tous les autres pays arabes.
2005- : cauchemars iraniens, cible syrienne
Les relations américano-saoudiennes sont au nadir et la rupture se profile à l’horizon mais l’épopée libératrice en Irak tourne au désastre au premier contact avec la réalité de l’administration du pays. L’Arabie saoudite revient dans les bonnes grâces américaines. Ses réserves au sujet de l’invasion de l’Irak se sont vérifiées. La dislocation de l’Irak renforce par ricochet l’Iran, lui-même objet de menaces américaines. Contre l’Iran, l’union se refait. À partir de 2005, Israël et son lobby aux États-Unis font campagne en faveur d’une attaque militaire. Arabie saoudite et Israël sont désormais atteints de l’obsession iranienne, l’une prétextant un danger chiite, l’autre un péril nucléaire.
Battant de l’aile, le plan de remodelage de la région est relancé lors du « printemps arabe ». Culbuter le régime syrien aurait le double avantage de permettre la dislocation de la Syrie en mini-entités communautaires et la dissolution de l’alliance Iran-Syrie-Hezbollah. Ben Laden éliminé, le djihadisme est orienté contre les musulmans « égarés » plutôt que contre les « Croisés » occidentaux. La crise libyenne catalyse le mouvement et la coalition anti-syrienne, dont l’Arabie saoudite, joue la carte djihadiste. Pressentant l’échec, les États-Unis se tiennent en retrait. Instruits par les fiascos en Afghanistan et en Irak, ils redoutent une conflagration générale dans la région.
Aussi une esquisse de changement de stratégie se fait-elle jour en 2013: mettre fin à l’affrontement avec l’Iran. Le projet s’intègre dans la redéfinition de la politique mondiale des États-Unis, l’« unique superpuissance » n’ayant pas réussi à mettre en place le « nouvel ordre mondial » et n’étant pas en état de mener seule une politique de force urbi et orbi. L’hypothèse d’un arrangement américano-iranien hante les alliés inconditionnels des États-Unis que sont Israël et l’Arabie saoudite. Le cauchemar iranien prend une forme nouvelle. Néoconservateurs et lobby israélien sont en ordre de combat contre le péril d’une accalmie entre Washington et Téhéran.
Perspectives
Il serait hasardeux de prédire une rupture américano-saoudienne. Même le tort fait au pétrole de schiste américain par la baisse des prix saoudiens est à relativiser, les deux parties se rejoignant sur la politique antirusse. Les États-Unis n’envisagent pas un renversement d’alliance, et ni Israël ni l’Arabie saoudite ne peuvent compter sur un autre garant international dans un avenir prévisible. L’Arabie saoudite n’a aucune assurance de pouvoir tenir à distance d’elle le djihadisme qu’elle entretient hors de ses frontières.
Plus réaliste est l’acquiescement israélien et saoudien à une entente américano-iranienne, advenant que l’accord intérimaire du 2 avril 2015 se traduise en accord définitif. [2] L’espoir des États-Unis est sans doute de ramener l’Iran dans leur giron, ce qui rappelle l’époque du shah à laquelle Israël et l’Arabie saoudite n’avaient rien à redire. S’il est très improbable que l’Iran se prête au rôle de roue du carrosse américain au Moyen-Orient, les relations américano-iraniennes s’apaiseraient à tout le moins.
Par Samir Saul, professeur d’histoire, Université de Montréal
[1] En 2014, elle accède au statut de premier importateur au monde d’équipements militaires.
[2] Samir Saul, « Vers une nouvelle architecture internationale », Le Devoir, 17 avril 2015, p. 7.