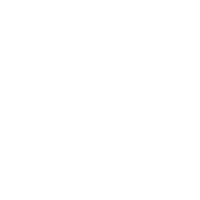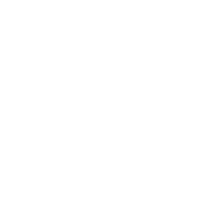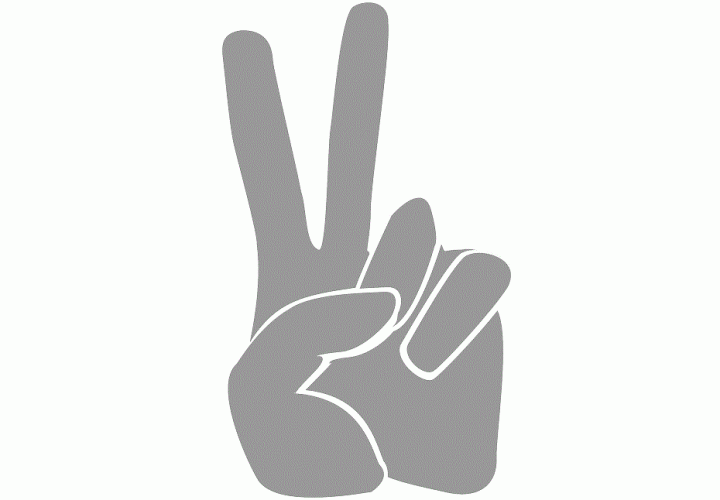
Ce billet est une invitation à lire les notes de recherche 1, sur le cas japonais, et 3 (à venir), sur les traités de paix, par Dominic Roy sur Monde68
Regrettablement, l’histoire nous a habitués à des fins de guerre décevantes, opposées au scénario envisagé par les vainqueurs. La «terminaison» de la guerre d’Irak en 2011 n’est à cet égard que la dernière déception versée au registre : après avoir obtenu la victoire militaire contre le régime de Saddam, les États-Unis se sont engouffrés dans une période de paix aux issues aussi incertaines que déplorables; pour ultimement devoir maintenant faire face à la menace de forces comme celles de l’État islamique. Lorsqu’il est question d’expliquer pourquoi certaines guerres réussies sur le plan militaire connaissent une issue politique ratée, quelques éléments peuvent être identifiés. Au compte des erreurs, nous retrouvons l’incapacité des vainqueurs à accepter l’idée que la réinsertion du vaincu au concert des nations est une condition fondamentale à un projet de paix durable. Pourtant, depuis le Congrès de Vienne de 1814-1815, le principe semble bien avoir démontré son efficacité. Sans cette condition, un État ostracisé risque à terme de vouloir forcer son retour par des moyens au potentiel catastrophique pour la paix. Non loin de là, un manque de modération de la part du vainqueur dans son effort à définir les contours de la paix nouvelle apparaît comme la source d’une vexation qui alimentera l’esprit de revanche chez le vaincu. Reconnaître et fixer «le point culminant de la victoire» est un exercice qui, en partie, doit prendre en compte le vaincu.[1] Or, la tentation est grande pour le vainqueur de ne concevoir la fin qu’au regard de ses désirs et de tenter ainsi de tirer le maximum de sa victoire. En cherchant à profiter à outrance d’une situation qui lui est favorable, le vainqueur risque plutôt de prolonger l’état de belligérance ou d’alimenter le terreau pour l’éclosion d’une nouvelle guerre. Pour le vainqueur, le défi est donc de contenir son appétit. Malencontreusement, comme en conviennent les réalistes[2], c’est là une exigence que la nature insatiable de l’homme rend bien improbable. L’insatisfaction et la recherche du gain optimal peuvent constituer des empêchements à la paix. Pour nous en convaincre, il n’est qu’à référer à l’inclémence qui affecte les Alliés à Paris et qui transparaît dans les clauses du traité de Versailles de 1919. Que l’on se souvienne seulement de l’ostracisme politique dont a souffert l’Allemagne et du désir de revanche qui a animé nombre de politiciens à Berlin au cours des années 1920 et 1930. Enfin, il est évident que les fruits de la victoire et la pérennité de la paix dépendent de la convergence des intérêts des alliés lors de la guerre et en période d’après-guerre. Vaincre en période de guerre nécessite des alliés, prévaloir en période de paix oblige à la coopération et à la bonne entente entre vainqueurs. Dans le cas contraire, la mésentente et bientôt la rupture de l’alliance peuvent ouvrir une période d’instabilité, laquelle peut éventuellement conduire à une nouvelle guerre. À titre d’exemple, l’opposition idéologique et la confrontation des ambitions stratégiques ont eu raison de la Grande Alliance américano-soviétique de la Seconde Guerre mondiale et se sont posées comme les fondations de la guerre froide. Globalement, ce qui rend les choses «simples» à ce niveau, c’est que ces conditions évoluent dans une relation duale : entre deux parties seulement, lesquelles sont du reste directement impliquées dans la guerre. D’évidence, il est donc entendu qu’une guerre réussie aux résultats politiques profitables dépend d’un échange satisfaisant entre vainqueur(s) et vaincu(s).
Ce qui semble moins évident au premier regard, c’est le poids que peut jouer un acteur externe (ou une coalition), totalement étranger à la guerre qui se termine. Or, il semble que la paix ne peut prendre naissance sans égard du contexte général. Pour qu’elle soit durable, la paix doit éviter d’incommoder les acteurs internationaux et doit satisfaire le minimum de leurs exigences. Si les droits ou les intérêts suprêmes d’une partie étrangère à la guerre sont bafoués ou que la communauté internationale suspecte la paix nouvelle d’être porteuse de menaces pour la stabilité, alors la contestation ne tardera pas à survenir. En raison d’opposition idéologique ou pour des considérations d’ordre matériel – par exemple, l’impossibilité de jouir d’une ressource (comme le pétrole) ou d’un territoire – des membres de la communauté internationale peuvent ainsi battre rappel diplomatique des termes d’une paix négociée parce qu’ils estiment que l’exploitation de la victoire et de la paix par le vainqueur brimerait leurs droits. Bien évidemment, il est sous-entendu qu’il s’agit ici de puissances internationales de poids; un État de stature négligeable aurait peine à influencer (seul) le cours des choses. Ultimement, un refus de la communauté internationale de reconnaître la légitimité de l’ensemble des gains du vainqueur peut reporter ou interdire les dividendes de la guerre. Bien qu’elle soit rare, une intervention par une tierce partie, non impliquée dans la guerre, peut ainsi obliger le vainqueur à reconsidérer comment il compte profiter de ses tributs de guerre. À titre d’exemple, rappelons que devant les insistances américaines et les menaces de récriminations, Israël (même appuyé par Paris et Londres) dut rétrocéder à l’Égypte une partie des territoires conquis du désert du Sinaï après la guerre de 1956, alors même que la victoire israélienne ne faisait aucun doute et que Le Caire avait évacué le territoire.
Si le vainqueur d’une guerre convient – et ce, en partie contre son gré – qu’il doit faire preuve de modération et œuvrer à la réinsertion du vaincu dans le concert des nations pour assurer durablement les fruits de sa victoire, il considère en revanche comme une aberration la possibilité qu’une tierce partie non impliquée puisse avoir son mot à dire sur l’entente qui met fin à l’état d’hostilité; pis encore, qu’elle puisse même ultimement rejeter celle-ci. S’il est admis que la pérennité de la paix repose sur la réinsertion du vaincu au sein du concert des nations, il est aussi essentiel que le vainqueur ménage son image auprès de la communauté internationale. Cela dit, accepter cette réalité apparaît aux yeux du vainqueur aller à l’encontre de toute logique et se pose comme un obstacle à son droit (opiniâtre) à profiter entièrement de sa victoire.
En somme, deux conclusions s’imposent à ceux qui ambitionnent à élaborer un projet de paix durable : 1) Danser le tango de la guerre exige deux partenaires, avance le dicton, et il en serait de même pour la valse de la paix. Planifier la paix sans égard au vaincu ou aux grands agents internationaux, c’est édifier sans fondations. 2) Si la victoire militaire sur le terrain est essentielle comme condition pour la terminaison du conflit, elle n’est guère plus qu’une opportunité politique offerte aux vainqueurs[3]. Contrairement à la confusion par trop de fois regrettablement remarquée dans le domaine des affaires stratégiques, la victoire ne conduit pas inéluctablement à la paix. Essentiellement, il importe que la vision obtuse et à court terme fasse place à la construction d’une grande stratégie. Voilà un projet tout aussi capital et évident qu’improbable.
Dominic Roy
Professeur d’histoire
[1] Raymond G. O’Connor, «Victory in Modern War», Journal of Peace Research, volume 6, numéro 4, 1969, p.379.
[2] Le réalisme est une théorie des relations internationales axée sur l’idée principale que l’ordre international est anarchique parce qu’il reproduit les comportements de la nature humaine; nature jugée belliqueuse.
[3] Michael Howard, «When Are Wars Decisive?», Survival, printemps 1999, p.130.